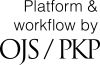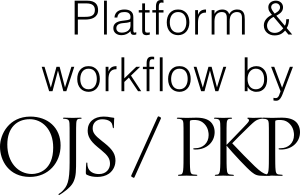La Revue Canadienne de Bioéthique est une revue avec comité de pairs bilingue (français et anglais), internationale, en ligne, en accès libre et de publication gratuite, qui vise à publier les résultats de la recherche théorique, conceptuelle et empirique en bioéthique. L’objectif de la revue est de fournir un espace pour la publication d’une recherche en bioéthique stimulante et de haute qualité, sous diverses formes.
ISSN: 2561-4665; Sherpa-Romeo
DOI: 10.7202/bioethics
Pour en apprendre davantage au sujet de la revue






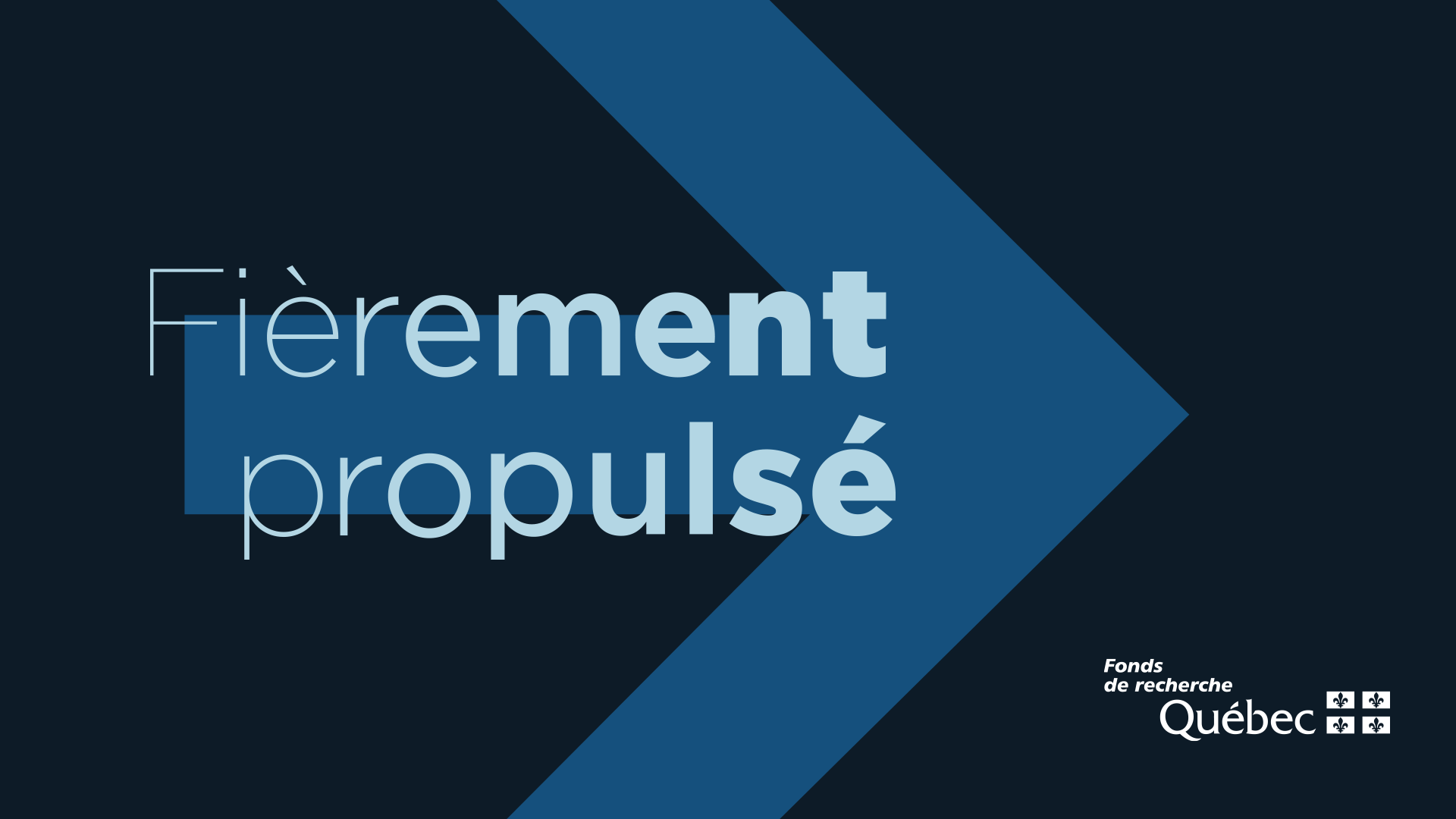




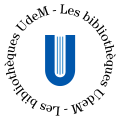



_smaller.png)